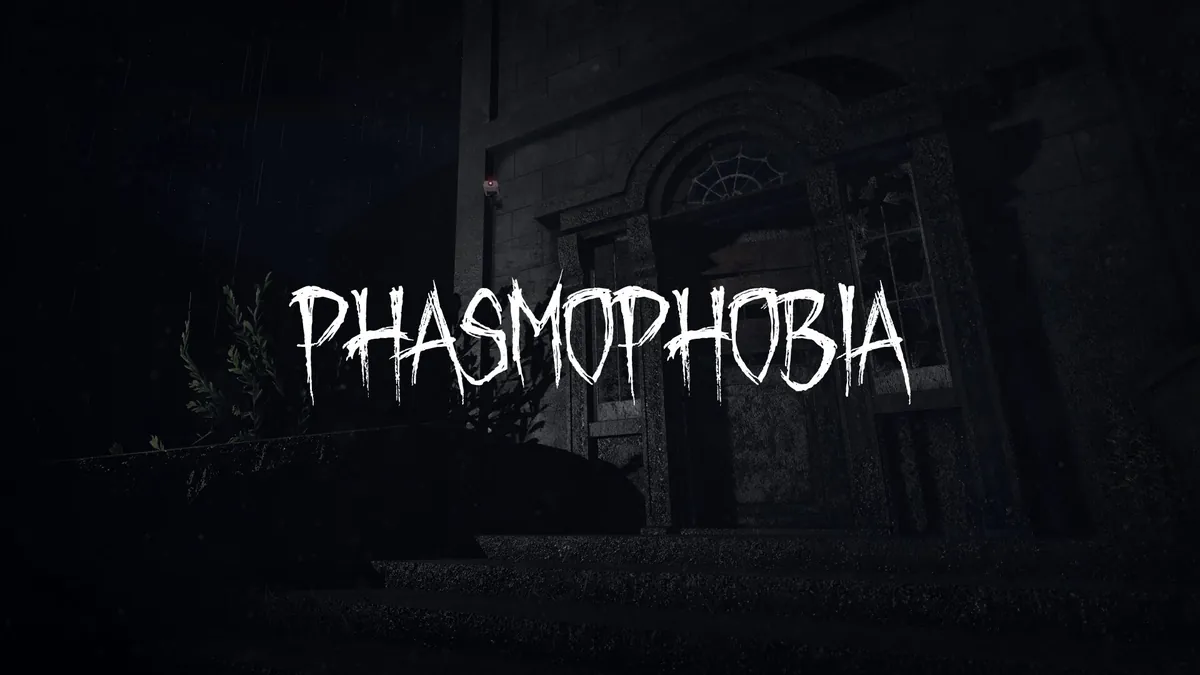Il y a 56 jours
Phasmophobia : Le Film, une Adaptation Audacieuse qui Veut Réinventer l’Horreur au Cinéma
h2
Quand Phasmophobia, le jeu d’horreur coopératif qui a terrifié des millions de joueurs, s’invite au cinéma sous l’égide de Blumhouse (The Conjuring, M3GAN). L’enjeu ? Transposer à l’écran son horreur procédurale et son immersion sonore unique, bien loin des recettes éculées des jump-scares. Avec un budget maîtrisé (5-10M$) et une collaboration sans précédent entre le studio et Kinetic Games, le film promet de révolutionner l’adaptation des jeux vidéo – à condition de relever un défi de taille : faire ressentir au spectateur ce que le joueur vit : l’angoisse de l’inconnu, les fausses pistes, et la terreur de l’invisible.
A retenir :
- Une alliance explosive : Blumhouse (maître du horror rentable) et Kinetic Games unissent leurs forces pour adapter Phasmophobia, avec la promesse d’une fidélité rare à l’univers du jeu.
- L’anti-Five Nights at Freddy’s : exit les jump-scares faciles, le film mise sur l’ambiance sonore immersive, les fantômes imprévisibles et une tension psychologique inspirée des mécaniques procédurales du jeu.
- Un défi technique inédit : comment recréer au cinéma l’interactivité du jeu ? Réponse possible : plans-séquences, son binaural et une narration qui joue avec les attentes du spectateur, comme le ferait un fantôme malicieux.
- Un budget "low-cost" mais ambitieux : entre 5 et 10M$, la marque de fabrique de Blumhouse, qui a déjà transformé des micro-budgets en phénomènes mondiaux (Paranormal Activity, 193M$ de recettes pour 15 000$ de budget).
- Une collaboration historique : contrairement à la plupart des adaptations, les développeurs du jeu sont impliqués en amont, avec des échanges réguliers pour préserver l’ADN de Phasmophobia – ses équipements (EMF, caméras thermiques), ses protocoles d’investigation, et surtout, sa peur organique.
- Un pari risqué : le film ne vise pas seulement les fans, mais cherche à redéfinir les codes du horror moderne, en prouvant qu’une adaptation de jeu vidéo peut être plus qu’un simple produit dérivé – une œuvre à part entière.
"On ne fera pas un film de chasse aux fantômes de plus" : la promesse audacieuse de Blumhouse
Quand Jason Blum, le patron de Blumhouse, annonce une adaptation de Phasmophobia, les attentes sont immédiates – et immenses. Le studio, responsable de certains des plus grands succès du horror moderne (The Conjuring, Get Out, M3GAN), a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer des concepts simples en phénomènes culturels. Mais cette fois, le défi est différent : Phasmophobia n’est pas un jeu narratif classique. Sorti en 2020, il a séduit par son approche procédurale et coopérative de la chasse aux fantômes, où chaque partie est unique, générée aléatoirement, et où la peur naît autant de l’inconnu que des interactions entre joueurs.
"Ce ne sera pas un film de chasse aux fantômes de plus." La déclaration de Corey J. Dixon, directeur artistique de Kinetic Games, est claire : l’adaptation ne se contentera pas de surfer sur la vague des franchises horrifiques. "Nous voulons capturer l’essence même de l’expérience Phasmophobia : cette sensation de ne jamais savoir ce qui va se passer, ces moments où vous retenez votre souffle en écoutant un bruit dans le noir, ces fausses pistes qui vous font douter de tout." Une ambition qui résonne particulièrement dans un paysage cinématographique souvent critiqué pour son manque d’originalité.
Pour y parvenir, Blumhouse mise sur ce qui a toujours fait sa force : un budget maîtrisé (entre 5 et 10 millions de dollars, comme pour Paranormal Activity ou Insidious) et une approche créative audacieuse. Le studio a prouvé à maintes reprises qu’il pouvait transformer des contraintes financières en atouts narratifs – à l’image de Paranormal Activity, tourné pour 15 000$ et ayant rapporté près de 200 millions. Mais ici, l’enjeu est double : non seulement il faut faire peur, mais il faut aussi recréer l’immersion qui a fait le succès du jeu.
Et c’est là que réside toute la complexité du projet. Phasmophobia n’est pas Resident Evil ou Silent Hill : il ne repose pas sur une histoire linéaire ou des personnages iconiques. Son génie tient dans ses mécaniques de gameplay – les équipements (comme le détecteur EMF ou la boîte à musique), les protocoles d’investigation, et surtout, l’imprévisibilité des fantômes, dont les comportements sont générés par des algorithmes. "Comment transposer cela à l’écran sans perdre ce qui fait l’âme du jeu ?", s’interroge Dixon. La réponse pourrait passer par une narration non-linéaire, des plans-séquences immersifs, et une bande-son travaillée en binaural pour donner au spectateur l’impression d’être dans la maison hantée, et non simplement devant.
Blumhouse + Kinetic Games : quand le cinéma rencontre le game design
La collaboration entre Blumhouse et Kinetic Games est peut-être l’élément le plus prometteur – et le plus rare – de ce projet. Dans l’industrie du cinéma, les adaptations de jeux vidéo ont souvent souffert d’un manque de dialogue entre développeurs et réalisateurs, conduisant à des résultats décevants (Assassin’s Creed, Warcraft). Ici, la dynamique est radicalement différente. "Ils [Blumhouse] sont vraiment ouverts à nos idées", confie Dixon. "On a des réunions régulières pour s’assurer que le film reste fidèle à l’esprit du jeu, sans pour autant devenir un simple 'film de jeu vidéo'."
Cette approche collaborative se traduit par des choix concrets. Par exemple, le film ne se contentera pas de montrer des chasseurs de fantômes en action : il intégrera des éléments clés du gameplay, comme l’utilisation des équipements (les caméras thermiques, les crucifix, les bougies) ou les protocoles d’identification des entités. "Imaginez une scène où les personnages doivent, comme dans le jeu, déterminer quel type de fantôme ils affrontent en fonction des indices sonores et visuels", explique Dixon. "C’est ce genre de détails qui feront la différence."
Autre point crucial : l’ambiance sonore. Dans Phasmophobia, le son est un personnage à part entière. Les pas qui résonnent dans le vide, les chuchotements incompréhensibles, le grésillement des talkies-walkies – tous ces éléments créent une tension permanente. Blumhouse, fort de son expérience avec Paranormal Activity (où le son jouait un rôle central), compte bien exploiter cette dimension. "On veut que le public ait l’impression d’entendre les fantômes murmurer derrière eux", révèle une source proche du projet. Pour y parvenir, l’équipe envisage d’utiliser des techniques de son binaural, qui donnent une impression d’immersion en 3D, ainsi que des silences calculés pour amplifier l’angoisse.
Enfin, la question du ton est essentielle. Phasmophobia oscille entre terreur pure et moments de légèreté (les joueurs qui hurlent de peur, les quiproquos entre coéquipiers). Le film devra trouver cet équilibre délicat. "Ce n’est pas un found footage classique, ni un slasher", précise Dixon. "C’est une enquête paranormale où l’horreur vient autant de ce qu’on voit… que de ce qu’on n’arrive pas à voir."
Le défi impossible : recréer l’interactivité du jeu à l’écran ?
Voilà le vrai casse-tête : Phasmophobia est un jeu interactif. Le joueur agit, décide, explore. Comment transposer cela dans un média passif comme le cinéma ? La réponse pourrait passer par une narration immersive, où le spectateur est plongé dans l’investigation au même titre que les personnages.
Plusieurs pistes sont évoquées :
- Des plans-séquences longs : pour donner l’impression d’une caméra subjective, comme si le spectateur faisait partie de l’équipe d’investigation. Blumhouse a déjà expérimenté cette technique dans Paranormal Activity, avec des plans fixes qui renforçaient le réalisme.
- Un son ultra-travaillé : comme mentionné plus haut, le binaural pourrait être utilisé pour créer une expérience audio à 360°, où les bruits semblent venir de partout – y compris derrière le spectateur.
- Une structure narrative fragmentée : le film pourrait alterner entre différents points de vue (celui des chasseurs, celui des fantômes, celui d’un "témoin" extérieur), pour recréer le sentiment de désorientation propre au jeu.
- Des fausses pistes visuelles : comme dans le jeu, où un bruit peut venir d’une pièce vide, le film jouerait avec les attentes du public, en détournant les codes du horror (par exemple, une porte qui claque… sans raison apparente).
Mais le plus grand défi reste peut-être l’imprévisibilité. Dans Phasmophobia, les fantômes agissent de manière aléatoire, ce qui crée une tension constante. Au cinéma, où tout est scénarisé, recréer cette sensation sera difficile. "On ne peut pas avoir un fantôme qui fait exactement la même chose à chaque projection", reconnaît Dixon. "Mais on peut jouer avec la perception du spectateur, en lui donnant l’impression que tout peut arriver." Une piste ? Utiliser des versions alternatives de certaines scènes (comme dans Clue, le film de 1985 qui proposait trois fins différentes), ou des détails changeants selon les projections (un objet qui bouge, un murmure différent).
Reste une question : le public est-il prêt pour un horror aussi expérimental ? Les adaptations de jeux vidéo ont souvent déçu (Doom, Hitman), et les attentes autour de Phasmophobia sont énormes. Mais si Blumhouse parvient à capturer l’essence procédurale du jeu, le film pourrait bien devenir une référence – non seulement pour les fans, mais pour tous les amateurs d’horreur intelligente.
Phasmophobia : et si le film devenait un laboratoire pour le horror moderne ?
Au-delà de l’adaptation elle-même, Phasmophobia pourrait bien servir de test grandeur nature pour le cinéma d’horreur. À une époque où les jump-scares et les franchises usées dominent les salles (Annabelle, The Nun), le film a l’opportunité de prouver qu’il existe d’autres façons de faire peur.
Plusieurs éléments jouent en sa faveur :
- Un public déjà captif : avec plus de 10 millions de joueurs sur Steam et une communauté active (notamment via le streaming), le film bénéficie d’une base de fans prête à le soutenir.
- Un studio qui ose prendre des risques : Blumhouse a déjà révolutionné le horror avec des films comme Get Out (horreur sociale) ou The Invisible Man (science-fiction horrifique). Phasmophobia pourrait être leur prochain coup de maître.
- Un contexte favorable : après le succès surprise de Five Nights at Freddy’s (plus de 290M$ de recettes mondiales), les adaptations de jeux horrifiques ont le vent en poupe. Mais là où FNAF misait sur la nostalgie et les jump-scares, Phasmophobia pourrait offrir une alternative plus mature et immersive.
Bien sûr, les sceptiques sont légion. "Un film sans jump-scares ? Sans monstre visible ? Ça ne marchera jamais en salles", estime Thomas V., critique pour Écran Large. "Les spectateurs veulent des frissons immédiats, pas une ambiance subtile." Un avis que ne partage pas Marie L., spécialiste du horror chez Première : "Blumhouse a déjà prouvé qu’on pouvait faire peur avec trois fois rien. Si ils arrivent à capturer ne serait-ce que 10% de l’immersion du jeu, ce sera déjà un énorme pas en avant."
Une chose est sûre : Phasmophobia a le potentiel pour redéfinir les règles. Entre l’expertise narrative de Blumhouse, l’innovation technique (son binaural, plans-séquences) et l’implication sans précédent des développeurs, le film pourrait bien devenir l’adaptation de jeu vidéo la plus fidèle et la plus ambitieuse à ce jour. À condition, bien sûr, de ne pas succomber à la tentation des facilités – comme un jump-scare mal placé, ou un fantôme trop visible.
Comme le résume Dixon : "Notre objectif n’est pas de faire un film sur Phasmophobia. C’est de faire un film qui fait ressentir Phasmophobia. Si on y arrive… ce sera une première."
Dans les coulisses : comment Blumhouse compte bien éviter les pièges des adaptations
Derrière les déclarations optimistes, la production de Phasmophobia est un équilibre délicat. Blumhouse a conscience des écueils : trop s’éloigner du jeu, et les fans seront déçus ; trop coller à la source, et le film perdra en accessibilité. Pour éviter cela, le studio a mis en place une stratégie en trois points :
1. Impliquer les développeurs… mais pas trop.
Contrairement à d’autres adaptations où les créateurs du jeu sont tenus à l’écart, Kinetic Games est consulté régulièrement. "On ne veut pas qu’ils écrivent le scénario, mais leur feedback est invaluable pour les détails", explique un producteur. Par exemple, l’équipe a insisté pour que les fantômes ne soient pas trop "humanoïdes" – dans le jeu, ils sont souvent des silhouettes floues, des ombres mouvantes. "Dès qu’un fantôme devient trop distinct, on perd en mystère", souligne Dixon.
2. Jouer avec les attentes du public.
Blumhouse compte sur l’effet de surprise. Le film ne commencera pas comme un horror classique : pas de maison hantée dès les premières minutes, pas de groupe de jeunes insouciants. À la place, une lente immersion, avec des scènes qui semblent anodines… avant de basculer dans l’angoisse. "On veut que le public se demande : 'Est-ce que ça a déjà commencé ?'", révèle une source.
3. Un tournage "à la Phasmophobia".
Pour recréer l’ambiance du jeu, l’équipe a décidé de tourner dans des lieux réels et abandonnés, avec un minimum d’effets spéciaux numériques. "On veut que les décors respirent la même atmosphère que dans le jeu : des endroits oubliés, où chaque craquement de plancher a un sens", explique le chef décorateur. Même les acteurs ont été soumis à des "protocoles d’immersion" : avant certaines scènes, ils devaient rester dans le noir, avec des casques diffusant des bruits de pas et des chuchotements – comme dans le jeu.
Enfin, Blumhouse a prévu un coup marketing audacieux : avant la sortie du film, une expérience interactive sera proposée dans certaines salles. Les spectateurs pourront, via une application, "scanner" l’écran pour découvrir des indices cachés, comme s’ils faisaient partie de l’équipe d’investigation. Une façon de brouiller les frontières entre jeu et cinéma, et de préparer le public à une expérience hors norme.
Reste à savoir si le public sera prêt à accepter une horreur moins spectaculaire, mais plus viscérale. Une chose est sûre : entre les plans-séquences angoissants, le son binaural, et une collaboration sans précédent entre cinéma et game design, Phasmophobia a toutes les cartes en main pour devenir l’adaptation la plus fidèle – et la plus terrifiante – jamais réalisée. À condition, bien sûr, que les fantômes du jeu daignent faire le voyage jusqu’à l’écran… et qu’ils y restent aussi imprévisibles qu’à l’accoutumée.