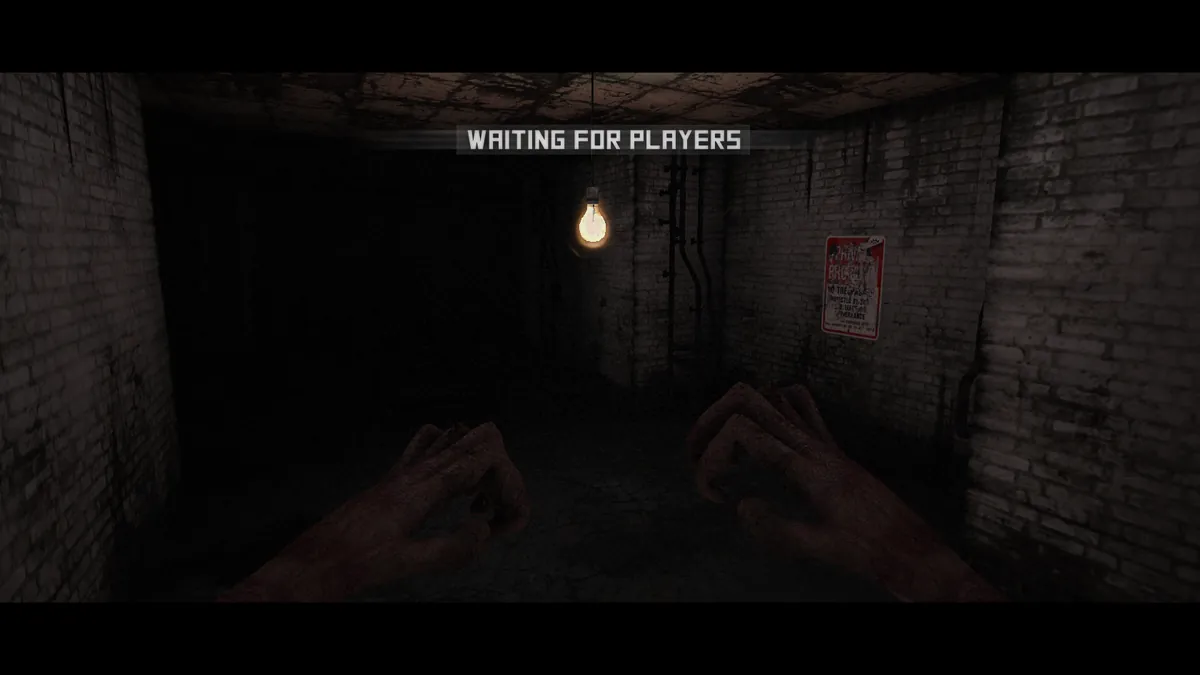**La conférence** : Quand le team building vire au massacre sanglant (et hilarant) sur Netflix
Un séminaire d’entreprise transformé en terrain de chasse sanglant, où le jargon corporate devient une question de vie ou de mort. La conférence, comédie horrifique suédoise de Patrik Eklund, mélange Shaun of the Dead et The Office pour un résultat aussi absurde qu’efficace. Entre gags potaches et scènes gores, ce slasher décalé explore l’enfer bureaucratique avec un humour noir mordant. À découvrir absolument sur Netflix pour les amateurs de frissons… et de critiques sociales bien placées.
A retenir :
- Un mélange explosif : Entre comédie potache et slasher gore, La conférence réinvente le film d’horreur en ciblant le monde impitoyable de l’entreprise.
- Des stéréotypes professionnels poussés à l’extrême : Le manager naïf, la RH cynique ou le stagiaire maladroit deviennent les proies (ou les bourreaux) d’un tueur masqué.
- Une satire qui fait mouche : "Optimisation des ressources" = survie, "synergie" = trahison… Le film détourne le jargon corporate avec un humour aussi noir que tranchant.
- Un ton unique : Entre l’absurdité de Severance (Apple TV+) et le côté "bande de potes" de Shaun of the Dead, mais avec une violence bien plus explicite.
- Un casting suédois impeccable : Katia Winter (Sleepy Hollow) et Eva Melander (Border) mènent la danse dans ce massacre bien orchestré.
Quand le powerpoint devient une arme mortelle
Imaginez : un hôtel isolé en pleine forêt suédoise, une poignée de collègues forcés de participer à un séminaire de "renforcement d’équipe", et un tueur masqué qui transforme les ateliers de motivation en scène de crime. La conférence (Konferensen), adapté du roman éponyme de Mats Strandberg, prend ce postulat absurde et en fait une comédie horrifique aussi drôle que sanglante. Le réalisateur Patrik Eklund, connu pour ses courts-métrages primés (comme Instead of Abracadabra, nommé aux Oscars), signe ici son premier long-métrage et prouve qu’il maîtrise l’art de mélanger l’horreur et l’humour avec une touche scandinave bien particulière.
Dès les premières minutes, le ton est donné : entre deux slides PowerPoint ennuyeux, un premier meurtre survient, aussi soudain que grotesque. Le film joue constamment sur ce décalage entre le cadre ultra-formel du séminaire et la violence brutale qui s’y invite. Les victimes ? Des employés lambda, chacun incarnant un archétype du monde professionnel : le manager trop enthousiaste, la RH manipulatrice, le commercial arrogant, ou encore le stagiaire timide qui va devoir survivre… coûte que coûte. Une prémisse qui rappelle The Office, si Michael Scott avait été remplacé par Jason Voorhees.
Ce qui frappe dans La conférence, c’est sa capacité à détourner les codes du slasher classique. Exit les adolescents insouciants des Vendredi 13 ou Halloween : ici, les proies sont des adultes coincés dans leur costume-cravate, et leurs dialogues regorgent de jargon d’entreprise détourné. Quand un personnage hurle "Il faut optimiser nos ressources !" alors qu’il tente d’échapper au tueur, on rit jaune… avant de frissonner. Le film pousse la logique jusqu’à l’absurde : une scène de poursuite se déroule pendant une présentation Excel, et une victime se fait poignarder en plein brainstorming. Un humour noir qui rappelle Shaun of the Dead, mais avec une froideur nordique bien plus glaçante.
"Synergie" rime avec trahison : la satire corporate qui tue (littéralement)
Si La conférence fonctionne si bien, c’est parce qu’il ne se contente pas d’être un slasher déjanté : c’est aussi une satire féroce du monde du travail. Le film exploite l’absurdité des dynamiques de bureau pour en faire un terrain de jeu macabre. Les ateliers de "communication non-violente" deviennent des pièges mortels, les exercices de "confiance" se transforment en duels sanglants, et les "feedback 360" sont littéralement une question de vie ou de mort. Une approche qui n’est pas sans rappeler Severance (Apple TV+), la série culte qui explorait déjà les dérives du capitalisme moderne… mais sans les scènes de démembrement.
Le génie du scénario réside dans sa façon de détourner le langage corporate. Quand un personnage propose un "plan d’action" pour échapper au tueur, ou qu’un autre évoque une "stratégie de sortie de crise" alors qu’il est couvert de sang, le film frappe là où ça fait mal : dans notre rapport au travail. Les dialogues sont truffés de ces perles, comme quand un manager paniqué lance : "On va devoir faire un point individuel avec chacun… ceux qui restent." Une critique sociale qui donne au film une épaisseur rare dans le genre, tout en gardant un rythme effréné.
Pourtant, La conférence évite soigneusement de tomber dans le moralisme. Le ton reste résolument potache, avec des gags visuels qui rappellent les comédies horrifiques des années 2000. Une scène où un personnage tente de se cacher dans un open space en poussant des classeurs pour bloquer une porte est à la fois hilarante et terrifiante. Le film joue constamment sur ce fil ténu entre rire et malaise, et c’est ce qui le rend si addictif.
Un casting suédois au top pour un massacre bien huilé
Côté interprétation, La conférence peut compter sur un casting solide, mené par deux actrices suédoises de talent : Katia Winter (Sleepy Hollow, The Catch), qui incarne une employée cynique et désabusée, et Eva Melander (Border, The Witch), dans le rôle d’une manager aussi déterminée que suspecte. Leur alchimie à l’écran donne au film une dimension humaine qui évite l’écueil du simple "massacre en série". Chaque personnage, même secondaire, est bien écrit et bénéficie d’un arc narratif qui ajoute de la tension.
Le réalisateur Patrik Eklund exploite pleinement leurs talents pour créer une dynamique de groupe crédible. Les conflits entre collègues, les alliances fragiles et les trahisons sont filmées avec un réalisme qui rend les scènes de violence encore plus choquantes. Quand un personnage se fait poignarder pendant une dispute sur les objectifs du trimestre, l’effet est à la fois comique et profondément dérangeant. Le film rappelle ainsi que l’horreur la plus terrifiante est parfois celle du quotidien… surtout quand ce quotidien inclut des réunions interminables.
Techniquement, La conférence est un sans-faute. La photographie, signée Jonas Alarik, alterne entre des plans larges qui soulignent l’isolement de l’hôtel et des séquences plus serrées pendant les scènes de meurtre. La bande-son, quant à elle, mélange des musiques d’ascenseur (pour les scènes de "travail normal") et des compositions plus angoissantes lors des poursuites. Un choix audacieux qui renforce encore le décalage entre le cadre professionnel et l’horreur qui s’y déchaîne.
Derrière les rires et le gore : une réflexion sur le travail moderne
Au-delà de son côté "slasher déjanté", La conférence pose une question troublante : et si le vrai monstre, c’était l’entreprise ? Le film pousse à l’extrême les dérives du management moderne, où les employés sont réduits à des "ressources" interchangeables. Quand un personnage se fait licencier en plein milieu d’une attaque au couteau, la scène est à la fois absurde et terrifiante… parce qu’elle n’est pas si éloignée de la réalité.
Cette dimension critique est d’ailleurs ce qui distingue La conférence des autres comédies horrifiques. Là où un Shaun of the Dead se contentait de parodier les films de zombies, La conférence s’attaque à un sujet bien plus actuel : l’aliénation au travail. Les personnages ne sont pas juste des proies pour le tueur ; ils sont aussi les victimes d’un système qui les a déjà "tués" symboliquement avant même que le massacre ne commence. Une idée renforcée par la fin du film (que nous ne spoilerons pas), qui laisse un goût amer derrière les fous rires.
Pourtant, le film évite soigneusement de tomber dans le cynisme pur. Malgré son humour noir et sa violence explicite, il garde une forme d’optimisme grinçant. Les personnages qui survivent le font grâce à leur capacité à briser les règles du monde corporate, que ce soit en refusant de jouer le jeu des ateliers ou en utilisant le jargon contre leurs bourreaux. Une leçon de vie… ou de survie.
Un film culte en devenir ?
Depuis sa sortie sur Netflix, La conférence a rapidement trouvé son public, devenant un phénomène viral parmi les amateurs de cinéma décalé. Les réseaux sociaux regorgent de mémes reprenant ses répliques cultes ("On va devoir revoir notre stratégie de communication interne"), et les critiques saluent son audace. Certains y voient même un nouveau classique du genre, à mi-chemin entre la comédie horrifique et la satire sociale.
Pourtant, le film divise. Certains spectateurs, habitués aux slasher plus traditionnels, peuvent être déstabilisés par son ton résolument absurde. Les scènes gores côtoient des gags dignes d’une comédie potache, et le mélange ne plaît pas à tout le monde. Mais c’est précisément ce qui fait la force de La conférence : son refus des catégories. Ni tout à fait une comédie, ni tout à fait un film d’horreur, il invente son propre genre… celui du "corporate slasher".
Comparaisons obligées : si vous avez aimé Severance pour sa critique du monde du travail, ou Shaun of the Dead pour son humour décalé, La conférence est fait pour vous. À condition d’accepter un niveau de violence bien plus élevé, et une touche scandinave qui rend le tout encore plus glaçant. Car oui, sous ses airs de farce sanglante, le film cache une réflexion bien plus sombre sur la nature humaine… et sur ce que nous sommes prêts à faire pour survivre. Même dans un séminaire.
Disponible sur Netflix, La conférence est bien plus qu’un simple divertissement gore : c’est une expérience cinématographique unique, où l’horreur le dispute à l’hilarité, et où chaque scène de meurtre est aussi une piqûre de rappel sur les absurdités du monde professionnel. À voir entre collègues… si vous osez. Et surtout, la prochaine fois que votre boss vous propose un team building, vérifiez bien qu’il n’y a pas de tueur masqué dans les parages.